À propos de l’amour





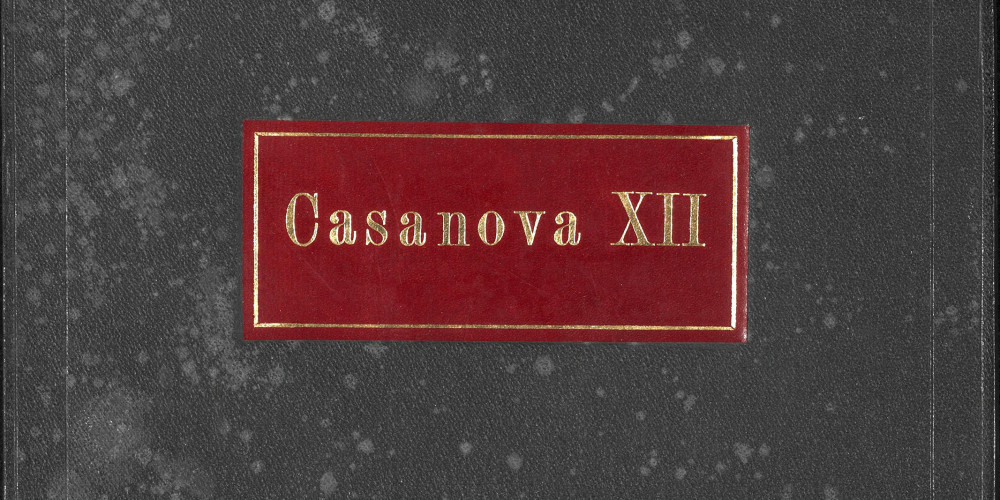






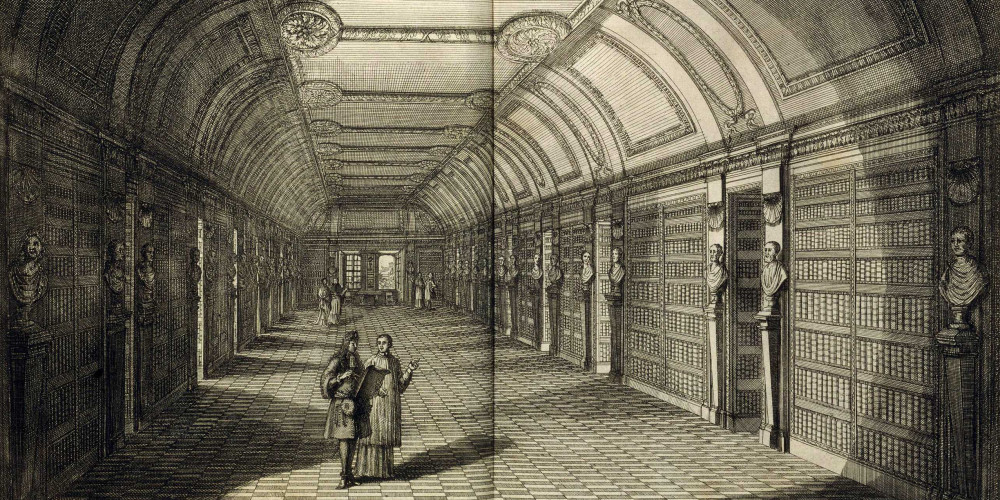
Contemporain du Don Giovanni de Mozart, Casanova explore comme lui les mille et une facettes de la séduction. Platonique ou charnel, durable ou passager, l’amour l’intrigue et le pousse à philosopher.
Mots-clés
Qu'est-ce donc que l’amour ?
« Qu’est-ce donc que l’amour ! J’ai beau avoir lu tout ce que les prétendus sages ont écrit sur sa nature, j’ai beau y philosopher dessus en vieillissant que je n’accorderai jamais qu’il soit ni bagatelle, ni vanité. C’est une espèces de folie sur laquelle la philosophie n’a aucun pouvoir ; une maladie à laquelle l’homme est sujet à tout âge, et qui est incurable si elle frappe dans la vieillesse. Amour indéfinissable ! Dieu de la nature ! Amertume dont rien n’est plus doux, douceur dont rien n’est plus amer. Monstre divin qu’on ne peut définir que par des paradoxes. »
Histoire de ma vie, I, p. 346
Mots-clés
Bibliothèque nationale de France
Qu’est-ce qu’un baiser ?
« Qu’est-ce qu’un baiser ? Ce n’est autre chose que le véritable effet du désir de puiser dans l’objet qu’on aime. »
Histoire de ma vie, I, p. 336.
Publié en 1789, le Monument du Costume Physique et Moral de la fin du dix-huitième siècle, ou Tableaux de la Vie rassemble 26 gravures de Freudeberg et Moreau le jeune, accompagnées de textes composés par Rétif de la Bretonne. Il s’agit de la compilation de plusieurs suites d’estampes commanditées par l’amateur d’art Jean-Henri Eberts et publiées en 1775, 1776, et 1783.
Cette estampe est issue de la Troisième Suite qui retrace les activités et loisirs d’un petit maître : on le voit se lever, séduire une dame, jouer au whist, aller à l’opéra, dîner en galante compagnie…
Mots-clés
Bibliothèque nationale de France
La femme est comme un livre
« La femme est comme un livre qui bon ou mauvais doit commencer à plaire par le frontispice ; s’il n’est pas intéressant il ne fait pas venir l’envie de le lire, et cette envie est égale en force à l’intérêt qu’il inspire. Le frontispice de la femme va aussi du haut en bas comme celui d’un livre, et ses pieds, qu’intéressent tant des hommes faits comme moi, donnent le même intérêt que donne à un homme de lettres l’édition de l’ouvrage. La plus grande partie des hommes ne prend pas garde aux beaux pieds d’une femme, et la plus grande partie des lecteurs ne se soucie pas de l’édition. Ainsi les femmes n’ont point tort d’être tant soigneuses de leur figure, et de leurs vêtements, car ce n’est que par là qu’elles peuvent faire naître la curiosité de les lire dans ceux qui à leur naissance la nature n’a pas déclaré pour dignes d’être nés aveugles [sic]. Or tout comme ceux qui ont lu beaucoup de livres sont très curieux de lire les nouveaux, fussent-ils mauvais, il arrive qu’un homme, qui a aimé beaucoup de femmes toutes belles, parvienne enfin à être curieux des laides lorsqu’il les trouve neuves. Il voit une femme fardée. Le fard lui saute aux yeux ; mais cela ne le rebute pas. Sa passion devenue vice lui suggère un argument tout en faveur du faux frontispice. Il se peut, se dit-il, que le livre ne soit pas si mauvais ; et il se peut qu’il n’ait pas besoin de ce ridicule artifice. Il tente de le parcourir, il veut le feuilleter, mais point du tout ; le livre vivant s’oppose ; il veut être lu en règle ; et l’egnomane* devient victime de la coquetterie, qui est le monstre persécuteur de tous ceux qui font le métier d’aimer. Homme d’esprit, qui as lu ces dernières vingt lignes, qu’Apollon fit sortir de ma plume, permets-moi de te dire que si elles ne servent à rien pour te désabuser tu as perdu ; c’est-à-dire que tu seras victime du beau sexe jusqu’au dernier moment de ta vie. Si cela ne te déplaît pas, je t’en fais mon compliment. »
Histoire de ma vie, I, p. 132
* Maniaque de la connaissance.
Mots-clés
Bibliothèque nationale de France
Pourquoi est-ce le visage qui nous fait devenir amoureux ?
« Eh quoi ! me disais-je, cette servante est belle, ses yeux sont bien fendus, ses dents blanches, l’incarnat de son teint est le garant de sa santé, et elle ne me fait aucune sensation ? Je la vois toute nue, et elle ne me cause pas la moindre émotion ? Pourquoi ? Ce ne peut être parce qu’elle n’a rien de ce que la coquetterie emprunte pour faire naître l’amour. Nous n’aimons donc que l’artifice et le faux, et le vrai ne nous séduit plus lorsqu’un vain appareil n’en est pas l’avant-coureur. Si dans l’habitude que nous nous sommes faite d’aller vêtus, et non pas tout nus, le visage qu’on laisse voir à tout le monde est ce qui importe le moins, pourquoi faut-il qu’on fasse devenir ce visage le principal ? Pourquoi est-ce lui qui nous fait devenir amoureux ? Pourquoi est-ce sur son témoignage unique que nous décidons de la beauté d’une femme, et pourquoi parvenons-nous jusqu’à lui pardonner, si les parties qu’elle ne nous montre pas sont tout le contraire de ce que la jolie figure nous les a fait juger ? Ne serait-il pas plus naturel et plus conforme à la raison, et ne vaudrait-il pas mieux aller toujours avec le visage couvert, et le reste tout nu, et devenir amoureux ainsi d’un objet, ne désirant autre chose pour couronner notre flamme qu’une physionomie qui répondrait aux charmes qui nous auraient déjà fait devenir amoureux ? Sans doute cela vaudrait mieux, car on ne deviendrait alors amoureux que de la beauté parfaite, et on pardonnerait facilement quand à la levée du masque on trouverait laid le visage que nous nous serions figuré beau. Il arriverait de là que seules les femmes qui auraient une figure laide seraient celles qui ne pourraient jamais se résoudre à la découvrir, et que les seules faciles seraient belles ; mais les laides ne nous feraient pas au moins soupirer pour la jouissance ; elles nous accorderaient tout pour n’être pas forcées à se découvrir, et elles n’y parviendraient à la fin que lorsque par la jouissance de leurs véritables charmes elles nous auraient convaincus que nous pouvons facilement nous passer de la beauté d’une figure. Il est par ailleurs évident et incontestable que l’inconstance en amour n’existe qu’à cause de la diversité des figures. Si on ne les voyait pas, l’homme se conserverait toujours amoureux constant de la première qui lui aurait plu. »
Histoire de ma vie, II, p. 364-365.
Mots-clés
Bibliothèque nationale de France
Le bonheur sur la terre
« J’aimais, j’étais aimé, je me portais bien, j’avais beaucoup d’argent, et je le dépensais ; j’étais heureux, et je me le disais, riant des sots moralistes qui disent qu’il n’y a pas de véritable bonheur sur la terre. C’est le mot sur la terre qui me fait rire comme si on pouvait aller le chercher ailleurs. »
Histoire de ma vie, II, p. 909.
Bibliothèque nationale de France
Qu’entend-on par bonheur durable ?
« Vivant ensemble, et goûtant les délices du vrai bonheur, nous nous moquions de la philosophie qui en nie la perfection ; parce que dit-elle, l’amour n’est pas durable.
― Qu’entend-on, me disait un jour Henriette, par ce mot durable ? Si on entend perpétuel, immortel, on a raison : mais l’homme ne l’étant pas, le bonheur ne peut pas l’être : sans cela tout bonheur est durable, car pour l’être il n’a besoin que d’exister. Mais si par bonheur parfait on entend une suite de plaisirs diversifiés et jamais interrompus, on a encore tort ; car en mettant entre les plaisirs, le calme qui doit succéder à chacun après la jouissance, nous nous procurons le temps de reconnaître l’état heureux de leur réalité. L’homme ne peut être heureux que quand il se reconnaît pour tel, et il ne peut se reconnaître que dans le calme. Donc sans le calme il ne serait jamais heureux. Donc le plaisir pour être tel a besoin de finir. Que prétend-on donc dire par le mot durable ? Nous arrivons tous les jours au moment où désirant le sommeil nous le mettons au-dessus de tout autre plaisir ; et le sommeil est la véritable image de la mort. Nous ne saurions lui être reconnaissants que quand il nous a quittés.
Ceux qui disent que personne ne peut être heureux pendant toute la vie parlent ainsi au hasard. La philosophie enseigne le moyen de composer ce bonheur, si celui qui veut se le faire reste exempt de maladie. Tel bonheur qui durerait toute la vie, pourrait être comparé à un bouquet composé de plusieurs fleurs qui feraient un mixte si beau, et si d’accord qu’on le prendrait pour une seule fleur. Quelle impossibilité y a-t-il que nous ne passions ici toute notre vie, comme nous avons passé un mois toujours sains, et sans que jamais rien ne nous manque ? Pour couronner notre bonheur, nous pourrions en âge très avancé mourir ensemble, et pour lors notre bonheur aurait été parfaitement durable. La mort pour lors ne l’interromprait pas ; mais elle le finirait. Nous ne pourrions nous trouver malheureux que supposant la possibilité de notre existence après la fin de la même existence, ce qui me semble impliquant. Es-tu de mon avis ? »
Histoire de ma vie, III, p. 506-507.
Mots-clés
Bibliothèque nationale de France
Accorder ou non ses faveurs
« J’étais amoureux de cette demoiselle, mais la fille de Sylvia, avec laquelle je n’avais autre plaisir que celui de souper en famille, affaiblissait cet amour qui ne me laissait plus rien à désirer. Nous nous plaignons des femmes qui, malgré qu’elles nous aiment, et qu’elles soient sûres d’être aimées, nous refusent leurs faveurs ; et nous avons tort. Si ces femmes-là nous aiment, elles doivent craindre de nous perdre, et par conséquent elles doivent faire tout ce qu’elles peuvent pour tenir toujours vivant le désir que nous avons de parvenir à les posséder. Si nous y parvenons, il est certain que nous ne les désirerons plus, car on ne désire pas ce que l’on possède ; les femmes donc ont raison de se refuser à nos désirs. Mais si les désirs des deux sexes sont égaux, pourquoi n’arrive-t-il jamais qu’un homme se refuse à une femme qu’il aime, et qui le sollicite ? La raison ne peut être que celle-ci : L’homme qui aime sachant d’être aimé fait plus de cas du plaisir qu’il est sûr de faire à l’objet aimé que celui que le même objet pourra lui faire dans la jouissance. Par cette raison, il lui tarde de le contenter. Le femme préoccupée de son propre intérêt doit faire plus de cas du plaisir qu’elle aura elle-même que de celui qu’elle donnera ; pour cette raison elle diffère tant qu’elle le peut, puisque se rendant, elle a peur de perdre ce qui l’intéresse le plus : son propre plaisir. Ce sentiment est propre à la nature du sexe féminin, il est uniquement la cause de la coquetterie que la raison pardonne aux femmes, et qu’elle ne saurait jamais pardonner à un homme. Aussi ne la voit-on dans l’homme que très rarement. »
Casanova, Histoire de ma vie, II, p. 57-58
Bibliothèque nationale de France
L’amour platonique
« Je brûlais pour elle ; mais son penchant à la littérature m’aurait-il rendu amoureux si je ne l’avais pas trouvée jolie d’avance ? Hélas ! Non. J’aime un ragoût, et je suis friand ; mais s’il n’a pas bonne mine, il me semble mauvais. Le premier objet qui intéresse est la superficie, c’est le siège de la beauté ; l’examen de la forme et de l’intérieur vient après, et s’il enchante, il embrase ; l’homme qui ne s’en soucie pas est superficiel. C’est un synonyme de méprisable en morale. Ce que j’ai trouvé de nouveau en moi, en allant me coucher, fut que dans mes tête-à-tête avec Hébé, de trois ou quatre heures, sa beauté ne me causait pas la moindre distraction. Ce qui me tenait dans cette contrainte n’était cependant ni respect, ni vertu, ni prétendu devoir. Qu’était-ce ? Je ne me souciais pas de le deviner. Je savais seulement que ce platonisme ne pouvait pas durer longtemps, et en vérité, je m’en sentais mortifié ; cette mortification venait de vertu, mais d’une vertu à l’agonie. Les belles choses que nous lisions nous intéressaient si fort que les sentiments d’amour, devenus accessoires, ou secondaires, devaient se taire. Devant l’esprit le cœur perd son empire, la raison triomphe, mais le combat doit être court. Nos victoires nous abusèrent ; nous nous crûmes sûrs de nous-mêmes, mais sur un fondement d’argile ; nous savions d’aimer, mais nous ne savions pas d’être aimés. »
Histoire de ma vie, II, p. 891-892.
Mots-clés
Bibliothèque nationale de France
Se donner en corps et en âme
« Cela est dans la nature ; une femme remplie de sentiments croit de ne pouvoir pas faire davantage pour un homme qui lui a fait un bienfait, que de se donner à lui en corps et en âme. Je crois qu’un homme pense différemment ; la raison est que l’homme est fait pour donner, la femme pour recevoir. »
Histoire de ma vie, III, p. 507.
Mots-clés
Bibliothèque nationale de France
Les filles françaises sacrifiées à Vénus
« Les filles françaises qui se sont sacrifiées à Vénus, ayant de l’esprit et quelque éducation, sont toutes dans l’esprit de la Valville ; elles n’ont ni passion ni tempérament, et par conséquent elles n’aiment pas. Elles sont complaisantes, et leur projet est un seul et toujours le même. Maîtresses de dénouer, elles nouent avec la même facilité, et toujours riant. Cela ne vient pas d’étourderie, mais d’un vrai système. S’il n’est pas le meilleur, c’est au moins le plus commode. »
Histoire de ma vie, III, p. 435-436.
Mots-clés
Bibliothèque nationale de France
Du caractère des filles vénitiennes
« Dans ce même temps une jeune Vénitienne très jolie, que son père Ramon exposa à l'admiration du public la faisant figurer dans les ballets, me mit pour une quinzaine de jours dans ses fers ; j'y serais resté davantage si l'hymen ne les eut brisés. [...] sa protectrice lui trouva un mari de compétence dans le danseur français nommé Binet, qui d'abord voulut s'appeler Binetti. Par là sa femme ne se vit pas obligée à changer en français son caractère vénitien qui la mit à même de déployer sa force dans plusieurs aventures qui lui donnèrent de la célébrité. [...] La Binetti fut privilégiée par la nature du plus rare de tous les dons. L'âge ne parut jamais sur sa figure avec une indiscrétion, dont les femmes ne connaissent pas la plus cruelle. Elle parut toujours jeune à ses amants et aux plus fins connaisseurs des traits surannés. Les hommes ne demandent pas davantage. »
Histoire de ma vie, I, p. 407.
Mots-clés
Bibliothèque nationale de France
Nouer des intrigues dans les foyers des théâtres
« Les foyers des théâtres sont le noble marché où les amateurs vont exercer leur talent pour nouer des intrigues. J’avais su assez bien profiter de cette agréable école ; je commençais par devenir l’ami de leurs amants en titre, et je réussissais par l’art de ne jamais montrer la moindre prétention, et surtout de paraître non pas inconséquent, mais sans conséquence. Il fallait avoir toujours à l’occasion la bourse à la main, mais il s’agissait de peu de chose, la peine n’était pas si grande que le plaisir. J’étais sûr que d’une façon ou de l’autre on m’en tiendrait compte. »
Casanova, Histoire de ma vie, II, p. 78-79.
Mots-clés
Bibliothèque nationale de France
Les femmes poètes
« Toutes les femmes poètes qui existèrent depuis Homère, depuis les sibylles jusqu’à nous, furent toutes dévouées à Vénus. Sans cela leur nom ne serait pas passé à la postérité, car elles ne pouvaient devenir célèbres que rendues immortelles par les plumes de ceux qui jouirent d’elles. Personne ne connaîtrait Corilla, si elle n’avait pas su se faire des amants, et à Rome on ne l’aurait jamais couronnée, si elle n’avait pas rendu fanatique ce prince Gonzaga Solferino [...]. »
Histoire de ma vie, III, p. 756.
Mots-clés
Bibliothèque nationale de France
Bibliothèque nationale de France, 2011
